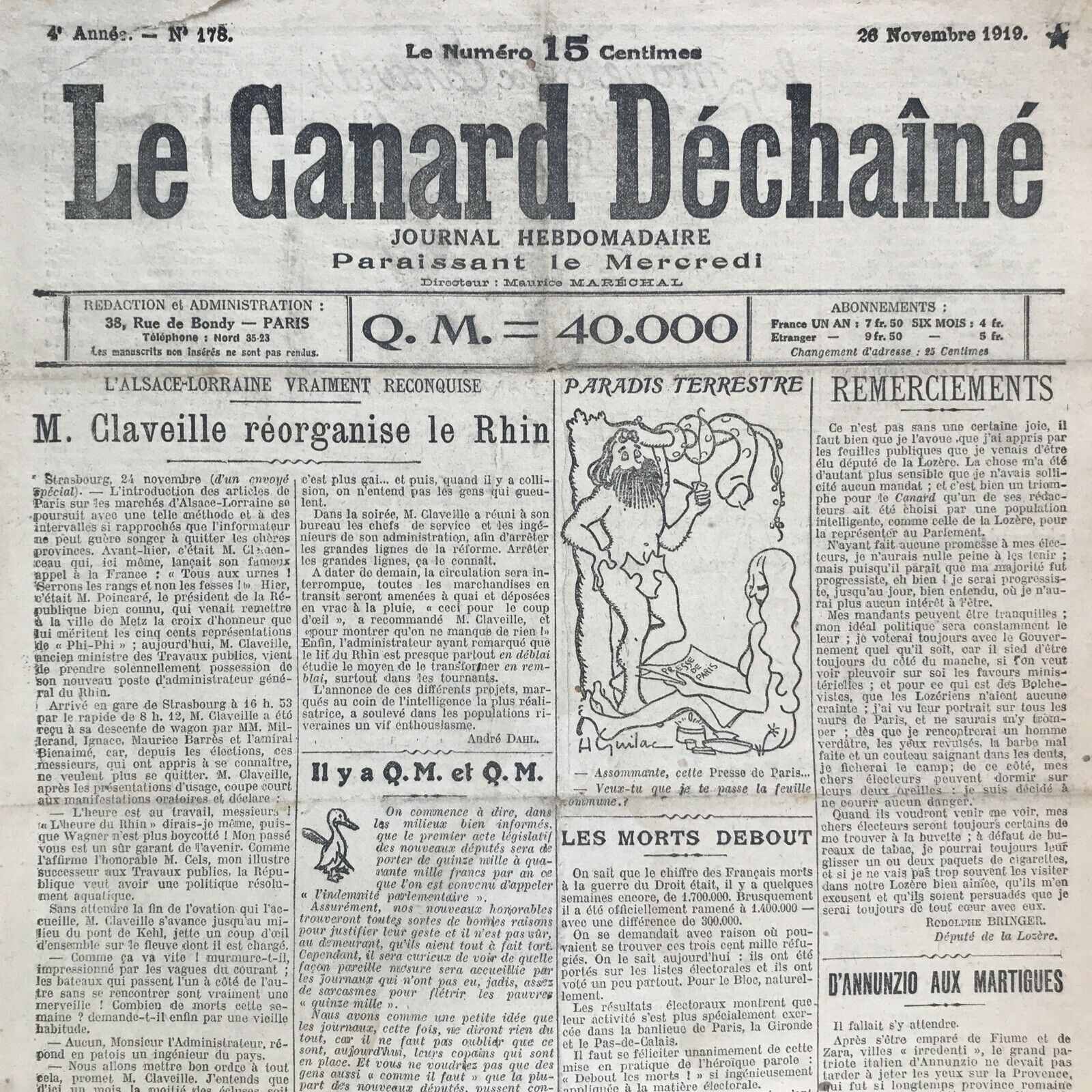N° 178 du Canard Enchaîné – 26 Novembre 1919
N° 178 du Canard Enchaîné – 26 Novembre 1919
89,00 €
En stock
L’inauguration du monument Lecomte et Clément-Thomas, aux premières victimes du bolchevisme – Émouvant discours de M. Clemenceau
À Montmartre, Clemenceau joue les orateurs de la mémoire. L’inauguration du monument en hommage aux généraux Lecomte et Clément-Thomas, tués par les Communards en 1871, devient sous sa plume et sa voix un procès rétrospectif du « bolchévisme ». Devant une foule recueillie, le Tigre enjambe quarante-huit ans d’histoire pour relier la Commune à la menace soviétique. Roland Catenoy ne manque pas d’épingler l’habileté rhétorique : derrière l’émotion officielle, une stratégie politique de l’heure, taillée pour sanctifier le Bloc national et prolonger l’« union sacrée » contre un ennemi réinventé.
Landru chez le Juge, dessin de Oberlé –
Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix
En stock
L’article de Roland Catenoy, daté du 26 novembre 1919, illustre à merveille l’art du Canard déchaîné de débusquer, sous les grandes cérémonies officielles, les arrière-pensées politiques. L’événement semble solennel : l’inauguration, à Montmartre, d’un monument en mémoire des généraux Lecomte et Clément-Thomas, exécutés par les Communards au début de la Semaine sanglante de 1871. Mais la plume de Dorgelès souligne combien ce rituel mémoriel devient une tribune pour Clemenceau, alors président du Conseil, qui transforme l’hommage en acte de combat idéologique.
Le décor est planté avec minutie : foule massée sur la butte, piquet de cuirassiers, autorités en grande tenue. La statue s’élève comme un rappel d’ordre et de sacrifice, et Clemenceau, acclamé, s’avance pour prendre la parole. Son discours, retranscrit dans ses grandes lignes, s’appuie sur une rhétorique redoutablement efficace. Il se présente d’abord en témoin de 1871 : jeune maire du XVIIIe arrondissement, il aurait tenu tête aux Communards, incarnant déjà la résistance. Puis, élargissant le propos, il fait du monument une arme contre « l’hydre bolchévique » contemporaine.
C’est là que la satire perce. En liant les Communards de 1871 aux bolchéviques de 1919, Clemenceau opère une construction historique commode : la gauche révolutionnaire devient une menace permanente, une continuité de désordre qu’il appartient au Bloc national de contenir. La mémoire des morts est ainsi instrumentalisée pour nourrir l’actualité : à travers l’évocation des sacrifices passés, le Tigre justifie la nécessité d’une vigilance de tous les instants contre Moscou, et légitime sa propre politique d’ordre.
Dorgelès met en lumière, sans lourdeur, ce glissement du deuil au discours. La cérémonie, censée unir dans la mémoire des victimes, se mue en outil électoral, renforçant le clivage gauche-droite. La « fête pieuse » tourne au meeting, où l’on célèbre moins les généraux tombés que la victoire de Clemenceau sur ses adversaires politiques.
En définitive, l’article illustre deux constantes de l’après-guerre : d’une part, l’instrumentalisation du passé — ici la Commune — pour nourrir les peurs du présent ; d’autre part, la capacité du Canard déchaîné à dégonfler la solennité officielle par une ironie froide. L’émotion collective, réelle, est ainsi recadrée : derrière les statues de bronze, ce sont des calculs politiques bien vivants qui s’écrivent.