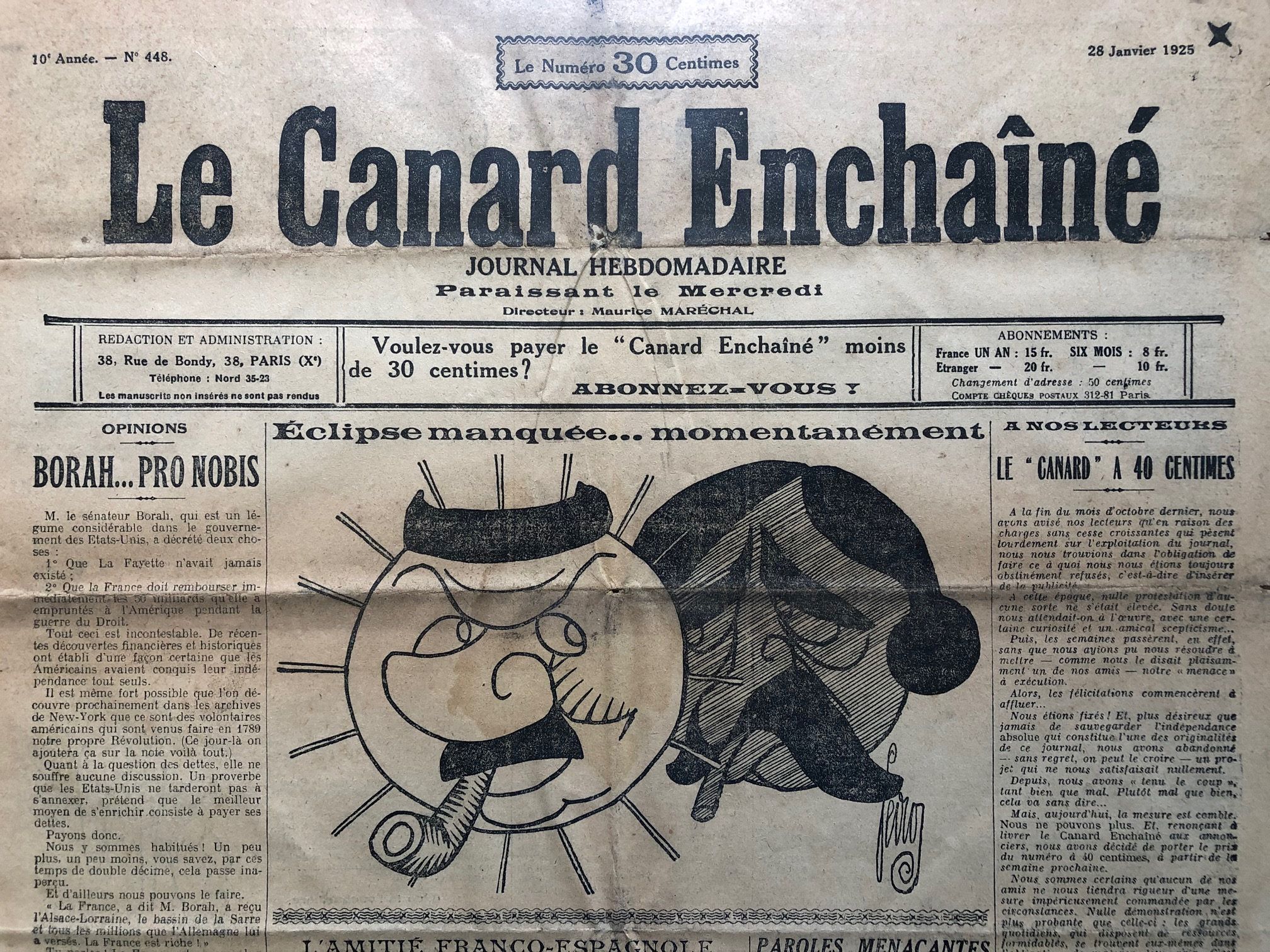Sous le titre latin ironique « Borah… pro nobis », Jules Rivet signe dans Le Canard enchaîné du 28 janvier 1925 une de ces tribunes où le rire se mêle à la colère. Le texte répond à une déclaration fracassante du sénateur américain William Edgar Borah, figure isolationniste et nationaliste du Congrès, qui vient d’exiger le remboursement immédiat par la France des dettes contractées envers les États-Unis pendant la Grande Guerre.
La situation est explosive : l’année 1925 s’ouvre sur un climat d’humiliation financière. La France, épuisée par la reconstruction et minée par la chute du franc, subit les pressions conjuguées de ses créanciers américains et britanniques. Les négociations sur les dettes de guerre s’enlisent, tandis que les États-Unis, enrichis par le conflit, exigent leur dû au nom du droit et de la morale. Dans ce contexte, Rivet transforme la polémique en pièce de satire patriotique.
Dès les premières lignes, le ton est donné : « M. le sénateur Borah, qui est un légume considérable dans le gouvernement des États-Unis… » Le mot « légume » suffit à ridiculiser le personnage et à souligner la disproportion entre sa puissance financière et sa petitesse d’esprit. Rivet s’amuse à pousser le raisonnement américain jusqu’à l’absurde : si la France doit rembourser, pourquoi ne pas admettre que La Fayette n’a jamais existé ? Et pourquoi ne pas découvrir bientôt que ce sont les Américains qui ont fait la Révolution française ? L’absurdité du propos de Borah est ainsi renvoyée à son propre grotesque.
Mais derrière l’humour perce la rancune. Rivet énumère avec amertume ce que la guerre a laissé à la France : « le dollar à 18 francs », « les discours de M. Poincaré », « les romans de M. Binet-Valmer », « le pain à trente et un sous » — autant de symboles d’une victoire appauvrissante. Il oppose ces « gains » dérisoires au sacrifice humain : 1,7 million de morts, 2 millions de mutilés. C’est toute la logique de la dette qui s’effondre sous la plume du satiriste : comment parler d’argent quand la France a payé en vies ?
La fin de l’article bascule dans la prophétie sarcastique. Rivet imagine une nouvelle guerre, où la France combattrait encore « joyeusement », à condition que cette fois les États-Unis prennent la place de l’ennemi : « Nous nous battrons contre les Allemands, à la condition que ce soit au tour d’avoir les États-Unis comme alliés. » L’inversion du rôle des alliés en adversaires souligne le désenchantement profond de l’après-guerre : les anciens compagnons d’armes sont devenus des créanciers, les libérateurs des marchands.
Le portrait final des Américains — « la graisse du corned-beef sur les dentelles de leurs wagons » — condense toute la verve de Rivet : à la fois moquerie du matérialisme yankee et rejet d’un impérialisme économique qui humilie une France ruinée.
Ce texte, publié alors que l’affaire des dettes de guerre fait rage à la Chambre, capte l’état d’esprit d’un pays qui découvre que la victoire n’a pas d’amis. Derrière le ton goguenard, Le Canard enchaîné fait œuvre de diplomatie satirique : rendre à Borah la monnaie de sa dette, mais en éclats de rire.