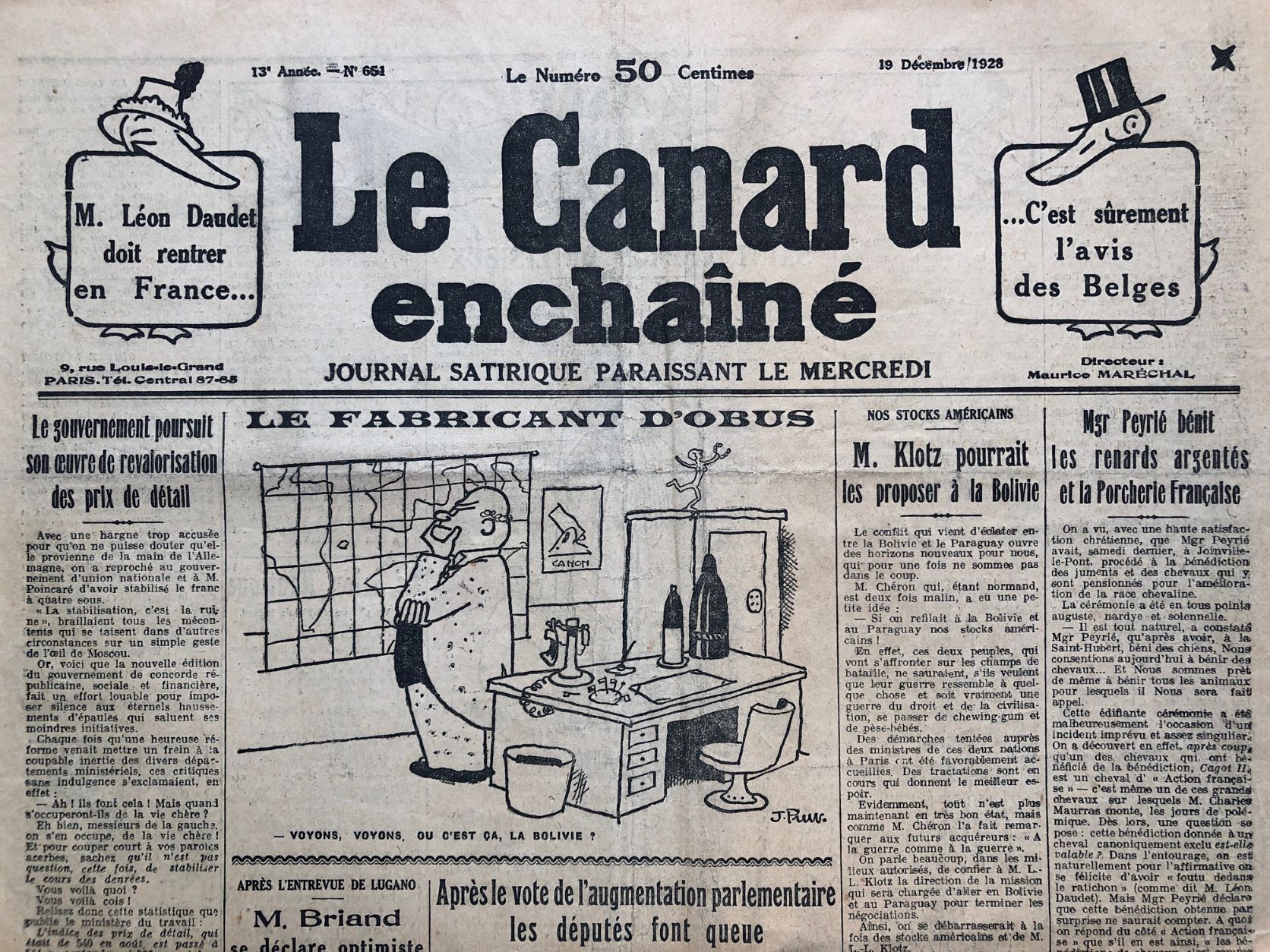À première vue, l’article de Bernard Gervaise, paru le 19 décembre 1928 sous la forme d’une causerie financière, semble partager l’indignation de la presse bourgeoise face au scandale de la Gazette du Franc. Mais dès les premières lignes, le ton trahit la supercherie :
“Évidemment, bien sûr, vue sous un angle particulier, cette affaire de la Gazette du Franc peut être considérée comme assez fâcheuse. Toutefois, il ne faut pas exagérer !”
Le lecteur du Canard sait d’emblée qu’il ne s’agit pas d’un éditorial de la Banque de France : Gervaise adopte le masque de la fausse sagesse, pour mieux dynamiter le discours officiel.
L’article s’inscrit dans le sillage des textes de Pierre Scize et Maurice Maréchal publiés les semaines précédentes. Après la chute de Marthe Hanau et l’effondrement de sa Gazette du Franc, Le Canard enchaîné a trouvé dans cette escroquerie financière — la plus retentissante de l’entre-deux-guerres — une matière à satire inépuisable. Là où les journaux sérieux dénoncent la “crise de la confiance”, Gervaise, lui, s’en amuse :
“Cent millions ! Je vous demande un peu s’il y a de quoi faire tant d’histoires ! L’épargne française est, Dieu merci, au-dessus de semblables bagatelles.”
Par ce ton faussement léger, il dévoile le cynisme d’un système financier qui banalise les pertes des petits porteurs tout en glorifiant les grands placements hasardeux — les fameux “emprunts russes”, évoqués ici comme un symbole national de naïveté lucrative.
Sous sa forme de causerie, l’article fonctionne comme un pastiches de chronique économique : des phrases courtes, des maximes pseudo-philosophiques, des détours rassurants, tous immédiatement contredits par le sous-texte. Quand Gervaise affirme qu’un épargnant n’est “qu’un monsieur qui fait des économies”, il démasque la vacuité morale du discours financier. Et lorsqu’il conclut, feignant de plaindre Marthe Hanau victime de la justice, il pousse l’ironie à son paroxysme :
“N’est-il pas permis de demander aux magistrats de quoi ils se sont mêlés ? Ce n’est pas leur zèle inopportun qui a causé la ruine d’une entreprise en pleine prospérité ?”
Sous couvert de défendre l’escroc, Gervaise renvoie les institutions — Justice, Banque, Presse — à leur propre incohérence : c’est leur aveuglement collectif qui rendait possible l’illusion Hanau.
Mais le sommet de la satire vient dans la seconde moitié du texte, quand il décrit le mécanisme absurde des “nouveaux bons” émis pour rembourser les anciens, puis les suivants — une parodie parfaite du système pyramidal avant l’heure :
“Les souscripteurs à leur tour se fussent trouvés payés sur les rentrées provenant d’un quatrième appel de fonds, lequel eût été suivi d’un cinquième, etc., etc…”
Le comique de répétition dit tout : l’économie se nourrit d’une confiance sans fin, que seule la chute rend visible.
En conclusion, Gervaise élargit le propos : il raille “ces braves gens” qui, vexés d’être traités de “poires”, iront “porter leurs disponibilités chez MM. Robert Macaire et Bertrand, les banquiers bien connus”. Le nom de Robert Macaire, archétype du spéculateur filou du XIXe siècle, achève le tableau : derrière la farce Hanau, c’est toute une tradition française de la combine légale qui perdure, bénie par l’État et rachetée par la presse.
Sous ses airs de chronique humoristique, Comment il faut protéger l’épargne française est en réalité une charge politique et morale contre l’époque de Poincaré. En décembre 1928, tandis que la France se félicite d’avoir “stabilisé le franc” et regagné la confiance des marchés, Le Canard enchaîné rappelle que cette stabilité repose sur la crédulité, la spéculation et la bonne conscience des rentiers.
Bernard Gervaise clôt ainsi, dans le rire, le cycle satirique ouvert par Maréchal et Scize : une trilogie où l’affaire Hanau devient le miroir déformant d’une République qui ne sait pas faire la différence entre une banque et un bonneteau.