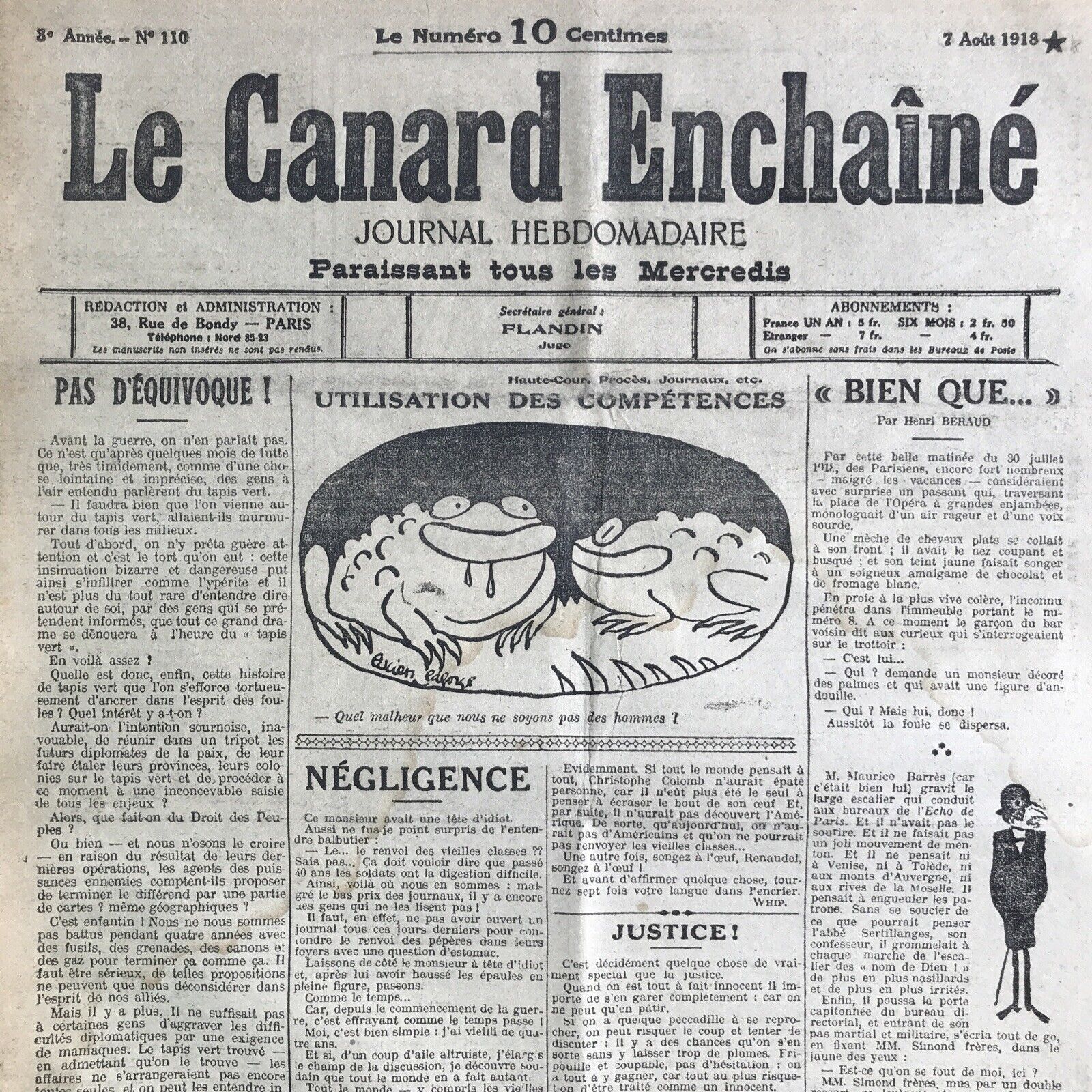N° 110 du Canard Enchaîné – 7 Août 1918
N° 110 du Canard Enchaîné – 7 Août 1918
89,00 €
En stock
BIEN QUE… – UNE HEURE chez Monsieur Gustave Hervé, par Henri Béraud
Dans cette édition de l’été 1918, Henri Béraud livre deux pièces de bravoure : une charge féroce contre Maurice Barrès, accusé de cynisme patriotard, et un portrait satirique au vitriol de Gustave Hervé, ancien révolutionnaire devenu apôtre de l’ordre et des prisons. Deux destins inversés, deux renégats à leur manière, disséqués avec l’art corrosif de Béraud, maître du pamphlet qui, en pleine guerre, ne pardonne ni l’opportunisme ni les volte-face spectaculaires.
Bonne réplique, dessin de Marcel Arnac – Confidences, dessin de Jif –
Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix
En stock
L’édition du 7 août 1918 du Canard enchaîné s’ouvre sur un double coup de plume d’Henri Béraud, qui prend pour cibles deux figures marquantes de la vie intellectuelle et politique de la Belle Époque : Maurice Barrès et Gustave Hervé. À travers eux, c’est tout un paysage de revirements, d’ambitions et de contradictions que le satiriste met en lumière, révélant l’âpreté des luttes idéologiques dans un pays épuisé par quatre ans de guerre.
Dans « Bien que… », Béraud met en scène un Barrès outré, furieux de voir sa réputation attaquée dans la presse. L’auteur de La Colline inspirée, devenu figure de proue du nationalisme belliqueux, est présenté comme un personnage théâtral, presque ridicule dans sa colère. Sa gesticulation verbale – « j’ai dit, j’ai dit, j’ai dit » – rappelle davantage les caprices d’un enfant que la stature d’un homme d’État. Béraud joue sur l’opposition entre l’image austère que Barrès veut donner de lui-même et la trivialité de ses emportements. En filigrane, il dénonce le cynisme de celui qui, après avoir exalté le romantisme national, se complaît désormais à prêcher la haine des « défaitistes » et des « bolcheviks ». C’est un portrait d’impuissance : celui d’un écrivain enfermé dans ses slogans, incapable de mesurer l’épuisement d’un peuple.
Avec « Une heure chez Monsieur Gustave Hervé », Béraud s’attaque à un autre symbole, mais dans un registre tout aussi caustique. Hervé, ancien agitateur antimilitariste, jadis « fou furieux » du socialisme révolutionnaire, est devenu l’apôtre de la discipline, de la police et des prisons. L’homme qui autrefois appelait les conscrits à refuser de marcher se vante désormais d’avoir inspiré des lois répressives et d’avoir « supprimé le divorce ». Béraud dresse un portrait glaçant de ce renégat, satisfait de son parcours de converti, et qui justifie sa trahison en invoquant la stabilité sociale et l’ordre public. La scène décrite dans son hôtel particulier, saturée d’images d’orgueil et de ridicule, montre un Hervé vieilli, jouant à l’homme d’État mais prisonnier de son reniement. L’ironie atteint son comble lorsque l’ancien révolutionnaire se vante de « coiffer les socialistes à la pelle », tournant sa mue idéologique en grotesque performance de bourreau.
La juxtaposition de ces deux portraits n’est pas fortuite. En choisissant Barrès et Hervé, Béraud illustre la faillite d’une génération intellectuelle : l’un s’enferme dans un nationalisme hystérique, l’autre dans une réaction autoritaire. Tous deux, à leurs manières, se sont éloignés de leurs idéaux premiers – l’un du romantisme de la jeunesse, l’autre de l’utopie révolutionnaire – pour se réfugier dans une posture de gardiens d’un ordre qui s’effondre. Le Canard s’en donne à cœur joie : derrière l’amusement, il y a le constat d’une défaite morale qui s’ajoute à la guerre en cours.
Ainsi, l’édition du 7 août 1918 met en évidence une leçon plus large : les renégats, qu’ils soient patriotes exaltés ou révolutionnaires repentis, finissent par devenir les caricatures d’eux-mêmes. Barrès et Hervé ne sont plus que des personnages de comédie, et Béraud, en pamphlétaire, s’assure que ses lecteurs en rient autant qu’ils s’en indignent.