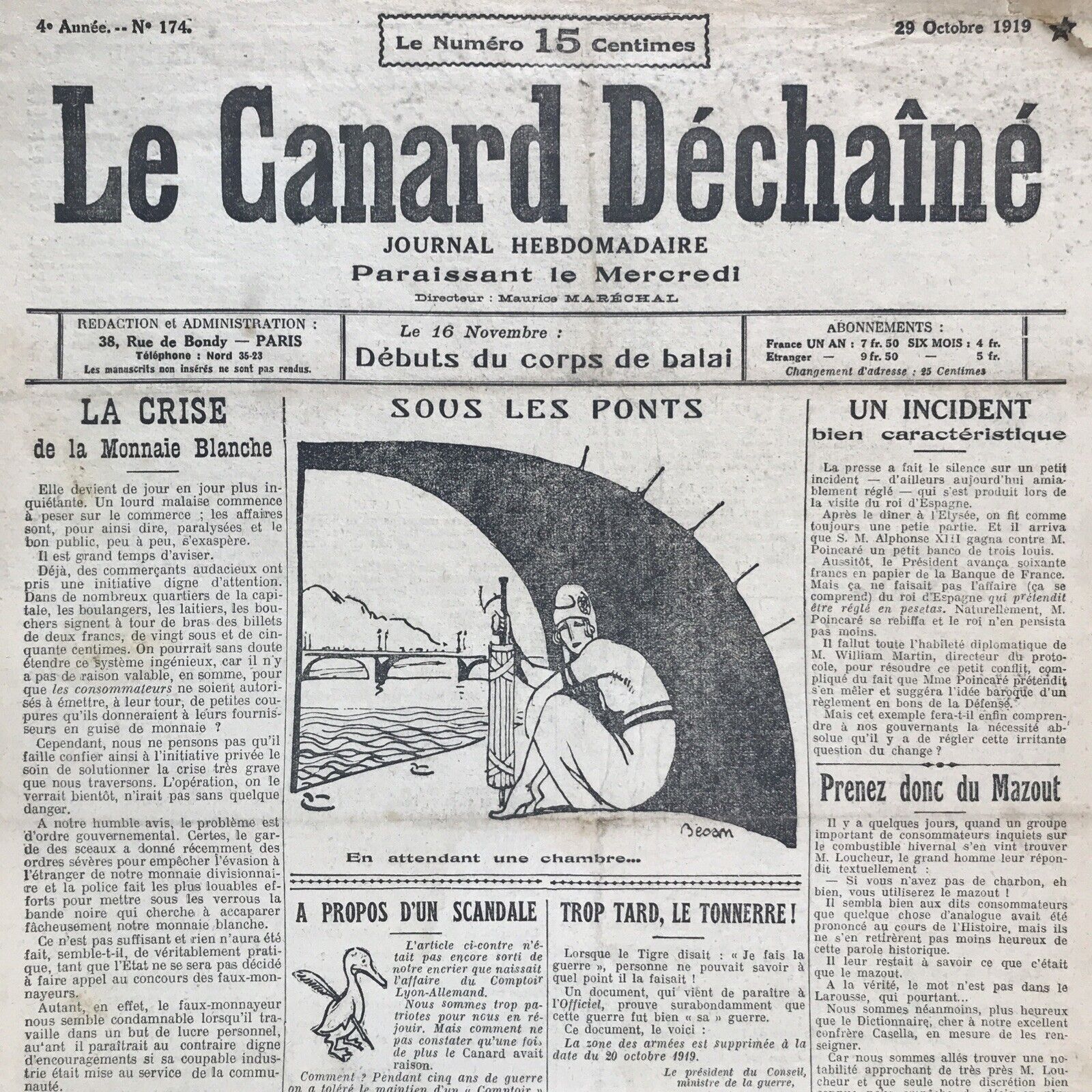N° 174 du Canard Enchaîné – 29 Octobre 1919
N° 174 du Canard Enchaîné – 29 Octobre 1919
89,00 €
En stock
M. Joseph Caillaux devant la Haute-Cour – Le dernier matin d’un juge –
Dans son édition du 29 octobre 1919, Le Canard déchaîné suit pas à pas la mise en scène pathétique du réveil et du transfert de M. Célerÿ de La Rombière, vieux sénateur sénile réquisitionné comme juge au procès Caillaux. Maurice Maréchal croque cette farce judiciaire où l’on traîne un vieillard à demi-inconscient pour sauver les apparences d’une Haute Cour qui ressemble plus à un théâtre qu’à un tribunal.
Sous les ponts, en attendant une chambre – Dessin de Bécan –Dans la crainte inspirée par le Bolchevisme en cette année 1919, le Bloc National (union des droites) fait campagne en amplifiant cette crainte en terreur. La chambre sera finalement « bleu horizon »et non rouge, le Canard tournant en dérision dans différents articles et dessins le bolchévique au couteau entre les dents et à l’origine de tous les maux.
Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix
En stock
Dans Le Canard déchaîné du 29 octobre 1919, Maurice Maréchal, plume fondatrice du journal, signe un récit à la fois glaçant et burlesque : celui du « dernier matin d’un juge ». L’affaire Caillaux, qui passionne alors la presse, prend ici une tournure de farce macabre. L’ancien président du Conseil, en prison préventive depuis 22 mois, doit enfin comparaître devant la Haute Cour. Mais pour sauver les apparences, encore faut-il un nombre suffisant de juges. Et c’est là qu’intervient le malheureux sénateur Célerÿ de La Rombière.
Le papier, construit comme un reportage judiciaire, se lit comme une satire du système parlementaire français. À quatre heures du matin, dans le brouillard parisien, médecins et huissiers pénètrent dans l’appartement du vieux sénateur, plongé dans un sommeil épais. On le tire de son lit, les yeux vitreux, incapable d’articuler autre chose que des borborygmes – « Gaga ga ga ga… » – avant qu’on ne l’aide à avaler une gorgée de sirop de morphine.
Ce portrait d’une décrépitude transformée en devoir civique est d’une cruauté assumée. Maréchal souligne l’absurdité de cette mascarade : l’homme, à peine conscient, est déclaré « apte » après un examen médical complaisant, puis installé dans une automobile qui file au galop « au pas de ses trente chevaux » vers le Palais du Luxembourg. La solennité du procès Caillaux se trouve ainsi réduite à une mise en scène bancale, où l’on exhibe un juge comme un pantin décrépit pour donner l’illusion de la justice.
Pour comprendre ce zèle, il faut rappeler l’acharnement de Clemenceau. Pendant la guerre, Joseph Caillaux avait incarné, aux yeux de ses adversaires, la figure honnie du défaitisme et des intrigues suspectes avec l’ennemi. Son opposition à l’entrée en guerre dès 1914, ses contacts en Italie ou en Suisse avaient nourri des accusations de trahison, relayées par une presse nationaliste vindicative. En 1917, au moment le plus critique du conflit, Clemenceau fait arrêter Caillaux : une manière de solder les comptes avec un rival politique de premier plan, dont l’ambition n’avait jamais désarmé.
Ainsi, le procès de 1919 n’était pas seulement judiciaire : il était politique. En traînant Caillaux devant la Haute Cour, Clemenceau voulait démontrer que la République avait puni ses « traîtres » intérieurs aussi sûrement qu’elle avait écrasé l’ennemi extérieur. Mais l’article de Maréchal montre que cette démonstration tourne à la farce : une justice expédiée à la hâte, soutenue par des juges fantômes, dont Célerÿ de La Rombière est la caricature.
Derrière l’humour grinçant, Le Canard dénonce une République qui, au lieu de rendre la justice sereinement, préfère organiser des procès-spectacles. Et rappelle que lorsque le pouvoir instrumentalise les tribunaux pour régler ses comptes, il ne produit qu’un théâtre d’ombres – grotesque pour les uns, inquiétant pour tous.