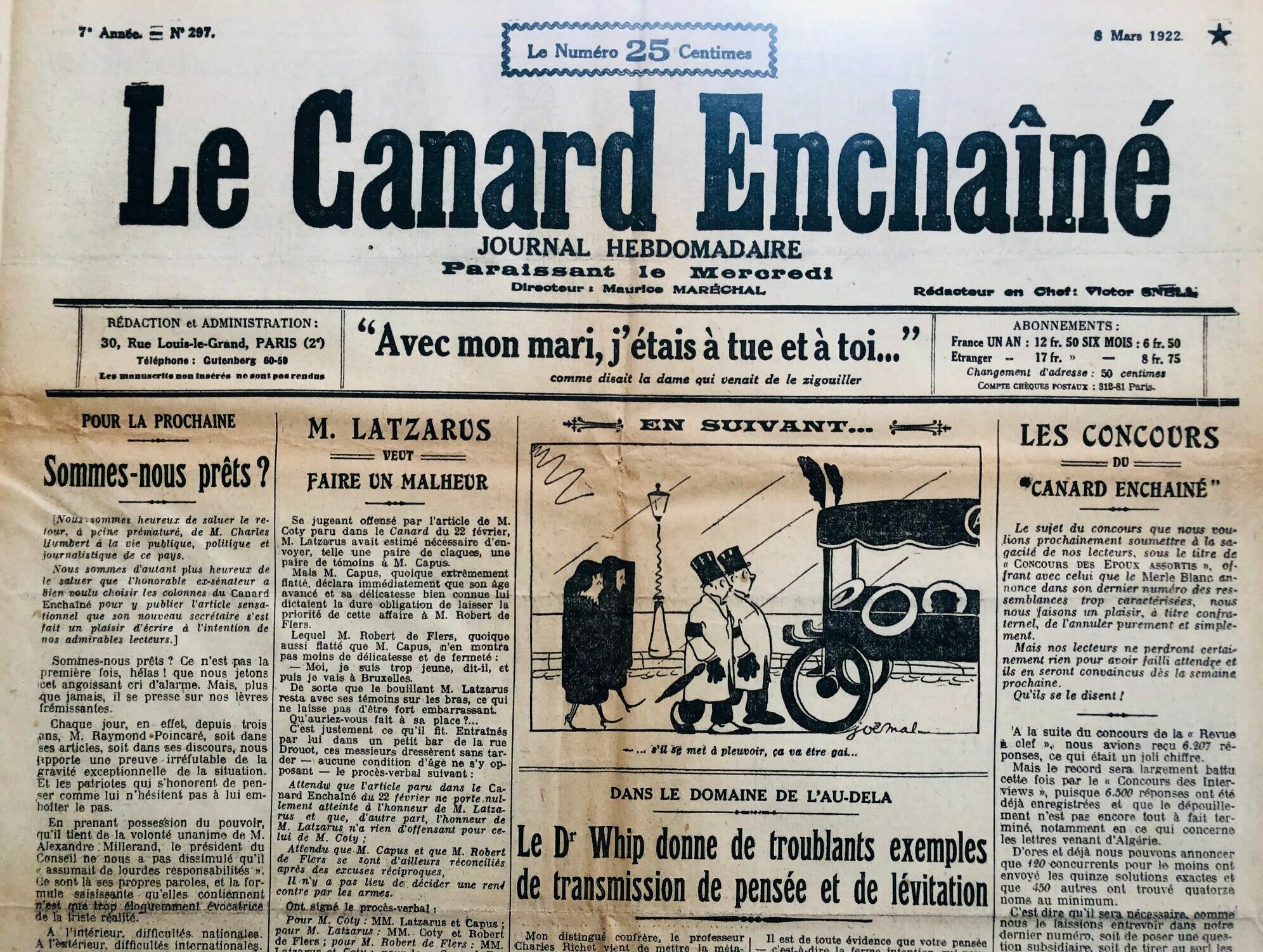N° 297 du Canard Enchaîné – 8 Mars 1922
N° 297 du Canard Enchaîné – 8 Mars 1922
79,00 €
En stock
La Révolution de Fiume – Dans la ville, les mandolines font rage
Le 8 mars 1922, Le Canard enchaîné envoie son humour à Fiume. Sous la plume de Rodolphe Bringer, les journées insurrectionnelles prennent des airs d’opérette : mandolines, carabiniers, fascistes affublés de sombreros et de trompettes. Loin du drame réel, c’est la mascarade des putschistes italiens qui est mise en scène, révélant à la fois le désordre politique d’après-guerre et la capacité du Canard à tourner les tragédies en bouffonneries.
Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix
En stock
En mars 1922, la petite ville de Fiume (aujourd’hui Rijeka, en Croatie) est encore le théâtre des soubresauts d’une Europe secouée par la Première Guerre mondiale et ses conséquences territoriales. Occupée par les troupes italiennes de Gabriele D’Annunzio en 1919 lors de la fameuse marche sur Fiume, elle avait été l’un des laboratoires du nationalisme violent qui annonçait déjà le fascisme mussolinien. Trois ans plus tard, l’agitation persiste : bandes armées, milices et contre-milices continuent d’y rejouer le grand théâtre de l’après-guerre.
C’est dans ce contexte que Rodolphe Bringer, plume caustique du Canard enchaîné, signe un faux reportage hilarant : « La Révolution de Fiume – Dans la ville, les mandolines font rage ». Dès les premières lignes, le ton est donné. L’envoyé spécial du journal prétend avoir débarqué grâce à un « pyroscaphe » chargé de grappas et de cigares, pour se retrouver face au « célèbre Quarnerò », caricature de chef local qui l’accueille avec un crucifix à la main et un verre de schnaps.
L’insurrection décrite se réduit à une bagarre de taverne : un fasciste qui fait la cour à une jeune femme, des gendarmes croates qui s’en mêlent, et voilà la « révolution » qui éclate. Les fascistes s’emparent alors de la ville « mandoline à la main », mêlant caricature de la violence politique et clichés de folklore méditerranéen. Le dessin de J. Pruvost, représentant des insurgés armés de fusils face à des musiciens en sombreros et trompettes, parachève cette mise en scène grotesque.
Derrière la farce, le Canard dénonce une réalité : le climat de désordre et de surenchère nationaliste qui mine l’Italie et inquiète l’Europe entière. En ridiculisant les putschistes de Fiume, Bringer anticipe déjà sur le danger que représente le fascisme mussolinien, alors en pleine ascension. La violence, banalisée et transformée en opérette, devient un avertissement : si l’on rit aujourd’hui de ces coups de théâtre, demain ils pourraient se transformer en tragédie politique.
L’article est aussi révélateur de l’art du Canard enchaîné en ce début des années 1920 : transformer les convulsions internationales en saynètes comiques, où l’envoyé spécial fictif se mêle aux insurgés avec une désinvolture absurde. La précision faussement journalistique (« Fiume, 7 mars, midi », « le prince de Monaco refuse ») renforce encore la parodie, en imitant les dépêches sérieuses pour mieux les détourner.
En somme, cette « révolution des mandolines » est un morceau de bravoure satirique : sous couvert de fantaisie, Bringer livre une critique de l’instabilité politique de l’Italie, en même temps qu’une leçon sur l’art de désamorcer l’actualité par le rire.
La véritable expédition de Fiume
En septembre 1919, le poète et ancien héros de guerre Gabriele D’Annunzio mène une expédition spectaculaire : avec environ 2 500 soldats nationalistes italiens, il marche sur Fiume, alors ville d’Autriche-Hongrie promise à la Yougoslavie par le traité de Londres (1915).
Cette occupation illégale, restée dans l’histoire sous le nom de « Régence italienne du Carnaro », dure quinze mois. D’Annunzio y proclame une constitution mêlant délires poétiques, corporatisme et militarisme. Culte du chef, exaltation de la jeunesse, liturgies de masse : Fiume devient un laboratoire du futur fascisme.
L’expérience prend fin en décembre 1920, quand l’armée régulière italienne reprend la ville lors du « Noël sanglant ». Mais l’héritage est durable : Mussolini, alors en train d’installer son pouvoir, récupère nombre de symboles et de rituels forgés par D’Annunzio.
En 1922, lorsque Bringer tourne en ridicule une nouvelle agitation à Fiume, il ne se contente pas de moquer un folklore : il s’attaque à l’un des berceaux du fascisme moderne, en dénonçant sa théâtralité et ses excès.