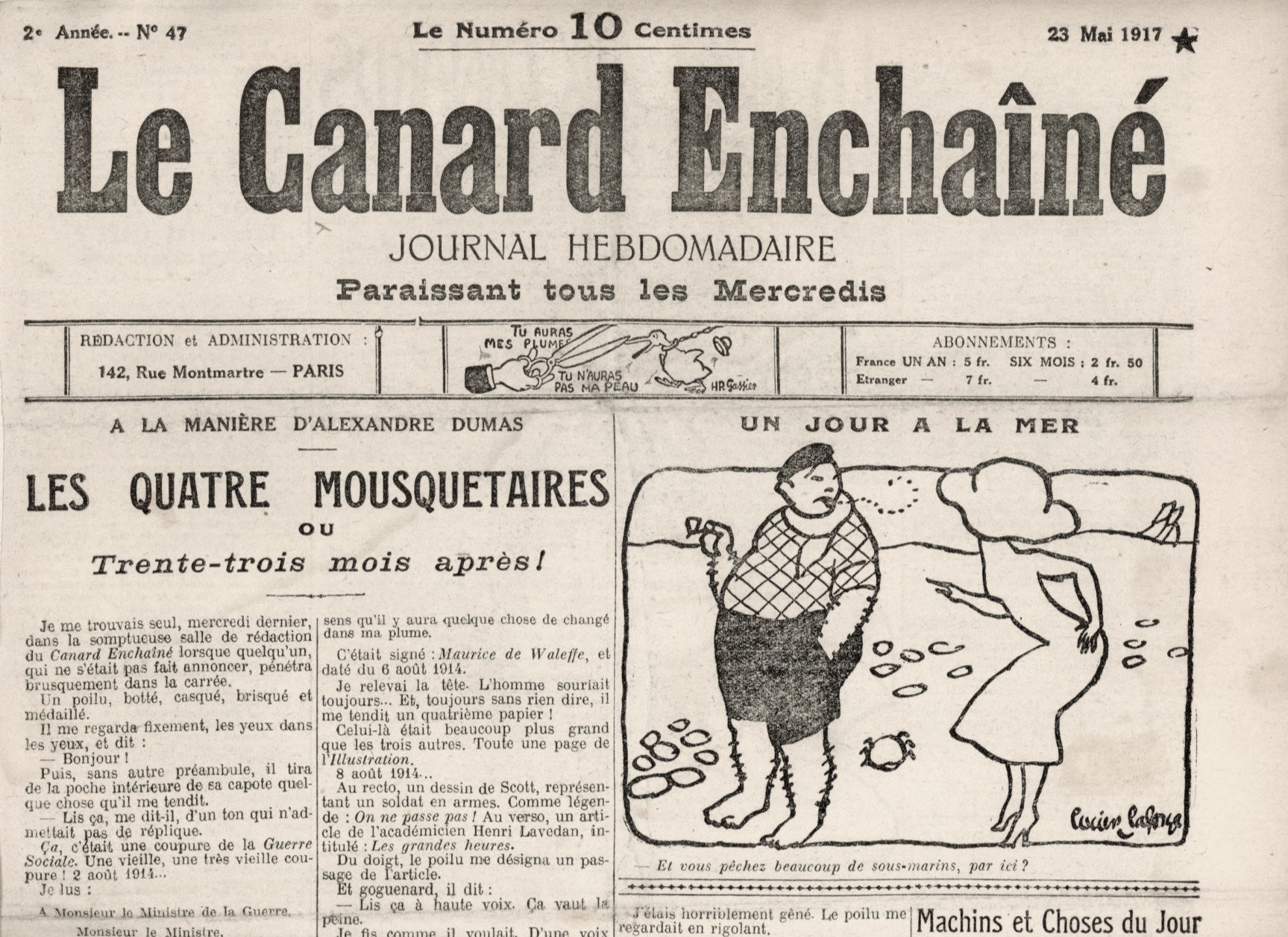N° 47 du Canard Enchaîné – 23 Mai 1917
N° 47 du Canard Enchaîné – 23 Mai 1917
89,00 €
En stock
LES QUATRE MOUSQUETAIRES ou Trente-trois mois après !
Le 23 mai 1917, Le Canard enchaîné joue les dramaturges : sous la plume de Maurice Maréchal, « Les Quatre Mousquetaires » reviennent hanter la rédaction, trente-trois mois après le début de la guerre. Dans une parodie d’Alexandre Dumas, les grandes plumes de la presse bourgeoise se retrouvent convoquées, comme autant de fantômes encombrants, face à un poilu goguenard qui juge leurs envolées patriotiques.
Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix
En stock
A la manière d'Alexandre Dumas, Les Quatre Mousquetaires ou Trente-trois mois après !
Avec « Les Quatre Mousquetaires ou Trente-trois mois après », Maurice Maréchal signe un texte à la fois théâtral et férocement satirique. L’article prend la forme d’une saynète « à la manière d’Alexandre Dumas » où surgit un mystérieux personnage botté, casqué, médaille au poitrail, venu confronter les illusions du journalisme patriotique à la réalité sanglante du front.
Maréchal convoque ici quatre noms : Gustave Hervé, l’ancien agitateur socialiste rallié à la guerre ; Léon Jouhaux, le syndicaliste devenu défenseur de l’union sacrée ; Henri Lavedan, académicien passé maître dans l’art des discours officiels ; et enfin Maurice de Waleffe, journaliste de l’Illustration qui, en août 1914, exaltait déjà l’héroïsme des soldats. Ces « mousquetaires » de papier, par leurs écrits de l’arrière, apparaissent comme les compagnons de route d’une propagande qui prétend galvaniser les troupes mais qui, aux yeux du Canard, sonne creux.
La mise en scène oppose leur verbe emphatique aux répliques sobres, presque désabusées, du poilu. Face aux citations de Jaurès, aux oraisons funèbres ou aux envolées nationalistes, le soldat rappelle, d’une voix lasse, la distance infranchissable entre la rhétorique et la boue des tranchées. L’effet comique naît précisément de ce décalage : Maréchal donne à lire un duel inégal entre le style emphatique des « grands » et la lucidité triviale de celui qui revient du front.
En recourant à la forme pastichée du roman de cape et d’épée, l’auteur détourne les codes héroïques pour mieux souligner l’usure des illusions. Les mousquetaires d’hier sont réduits à de simples feuillets jaunis, et leur gloire littéraire s’évanouit face au verdict du soldat. La satire n’épargne personne : ni les renégats comme Hervé, ni les officiels comme Lavedan, ni même les chefs syndicaux présentés comme récupérés par le pouvoir.
Ce texte est emblématique de l’art de Maréchal : un mélange de pastiche littéraire, de comique de situation et de critique politique acérée. En mai 1917, au moment où la lassitude gagne les tranchées et où les mutineries éclatent, Le Canard rappelle que les mots des plumes de l’arrière ne protègent pas des balles et que, pour les poilus, la vraie bataille n’est pas celle des discours.
Les « Quatre Mousquetaires » vus par Le Canard
En mai 1917, Maurice Maréchal imagine une galerie de personnages hauts en verve, qu’il baptise ironiquement « les quatre mousquetaires » : Gustave Hervé, Léon Jouhaux, Henri Lavedan et Maurice de Waleffe. Tous, chacun à sa manière, avaient pris la plume pour commenter la guerre, l’exalter ou la justifier. Leurs discours, très éloignés de la réalité des tranchées, offraient au Canard enchaîné une cible idéale. Hervé, l’ancien antimilitariste retourné nationaliste ; Jouhaux, le syndicaliste rallié à l’union sacrée ; Lavedan, l’académicien pompeux ; et Waleffe, le chroniqueur flamboyant : autant de figures de l’arrière, prompts à manier les mots plus qu’à partager les souffrances du front. En les réunissant sous le patronage d’Alexandre Dumas, Maréchal se moque de leur prétention à incarner l’esprit public : quatre bretteurs de papier, célébrés dans les salons et les colonnes des journaux, mais que le Canard ramène à leur statut d’hommes de lettres déconnectés.
Gustave Hervé (1871-1944)
Journaliste et militant politique, Gustave Hervé s’est d’abord illustré comme figure de l’antimilitarisme radical, au point d’être surnommé « l’homme qui plantait le drapeau rouge sur les casernes ». Fondateur du journal La Guerre sociale, il prône dans les années 1900 la désobéissance militaire et la révolution. Mais en 1914, il opère un spectaculaire revirement : rallié à l’Union sacrée, il devient l’un des plus farouches propagandistes de la guerre. Ce retournement lui vaut une large publicité et le transforme en polémiste nationaliste virulent, attaquant sans relâche socialistes, pacifistes et minoritaires. Ce parcours chaotique, de l’extrême gauche à la droite patriotarde, en fait une cible rêvée pour le Canard enchaîné, qui raille sa fougue devenue criarde. Le 23 mai 1917, Maurice Maréchal le place parmi ses « quatre mousquetaires », incarnation d’une éloquence tapageuse qui masque mal l’opportunisme. Sa trajectoire illustre combien la guerre fut aussi une affaire de retournements et de repositionnements idéologiques spectaculaires.
Léon Jouhaux (1879-1954)
Secrétaire général de la CGT à partir de 1909, Léon Jouhaux incarne l’ascension du syndicalisme ouvrier en France. Avant 1914, il défend une orientation réformiste, privilégiant la négociation et l’action légale aux ruptures révolutionnaires. Lorsque éclate la guerre, il se rallie à l’Union sacrée : la CGT met entre parenthèses ses revendications sociales pour soutenir l’effort militaire. Jouhaux devient ainsi le représentant d’un syndicalisme « patriote », rôle qui lui attire autant de reconnaissance officielle que de critiques acerbes. Pour ses adversaires, il symbolise la trahison de la cause ouvrière au profit des intérêts de l’État-major. En 1917, alors que le front s’enlise et que les grèves reprennent à l’arrière, Le Canard enchaîné le range parmi ses « quatre mousquetaires ». Dans la caricature de Maurice Maréchal, il apparaît comme l’orateur discipliné, prompt à rappeler l’orthodoxie patriotique. Après-guerre, Jouhaux poursuivra une longue carrière internationale, jusqu’à recevoir le prix Nobel de la Paix en 1951.
Henri Lavedan (1859-1940)
Dramaturge et romancier, Henri Lavedan est élu à l’Académie française en 1898. Auteur de pièces à succès, chroniqueur dans de nombreux journaux (Le Figaro, L’Écho de Paris), il s’impose par son style alerte, souvent ironique, mais aussi par une certaine propension au moralisme. Pendant la Grande Guerre, il se distingue comme écrivain patriote, publiant des textes vibrants en faveur de l’effort national et de la résistance aux « barbares ». Sa verve, que d’aucuns jugent pompeuse, lui vaut d’être régulièrement cité parmi les représentants d’une éloquence académique éloignée des réalités du front. Maurice Maréchal, dans son pastiche d’Alexandre Dumas publié par le Canard enchaîné le 23 mai 1917, en fait l’un des « quatre mousquetaires » de la plume. Avec sa stature d’académicien et ses accents de tribun, Lavedan symbolise l’intellectuel en habit vert prompt à discourir sur la guerre sans en partager les souffrances. Une figure idéale pour la satire antimilitariste du Canard.
Maurice de Waleffe (1874-1946)
Chroniqueur mondain et polémiste, Maurice de Waleffe se taille une place originale dans le paysage journalistique français du début du XXᵉ siècle. Collaborateur de L’Écho de Paris, puis fondateur du journal L’Intransigeant, il cultive un style flamboyant, volontiers provocateur, où se mêlent traits d’esprit et nationalisme militant. Durant la guerre, il met sa plume au service de la propagande, multipliant articles et chroniques enflammées pour exalter l’héroïsme français et vilipender l’ennemi. Ses excès, son goût de la formule et son lyrisme volontiers outrancier le rendent très populaire, mais aussi très critiqué. Le Canard enchaîné, qui n’épargne pas les « bourreurs de crânes », l’inclut parmi ses « quatre mousquetaires » dans l’édition du 23 mai 1917. Aux côtés d’Hervé, Jouhaux et Lavedan, Waleffe incarne ce journalisme d’arrière-front, plus soucieux de rhétorique que de vérité. En dehors de ses chroniques, il est aussi connu pour avoir créé en 1920 le concours de Miss France, autre témoignage de son sens de la publicité.
23 mai 1917, n°47 – Bicard [de La Fouchardière], « Les propos du Bouif »
Mai 1917. Dans les colonnes du Canard enchaîné apparaît un nouveau compère qui ne quittera plus vraiment le journal : Alfred Bicard, dit « le Bouif ». Créé par Georges de la Fouchardière, ce personnage de prolétaire gouailleur et imbibé, campé avec un mélange de truculence et de malice, va devenir l’un des miroirs les plus déformants – et donc les plus justes – de la société française.
Dans cette première livraison des « Propos du Bouif », le bonhomme s’installe au comptoir, un verre à la main, et commente l’actualité avec la logique bancale mais souvent plus pénétrante qu’il n’y paraît des « petits ». Sa syntaxe est cabossée, ses mots souvent de travers, mais il en ressort des vérités qui piquent. L’ivrogne, sous la plume de la Fouchardière, devient un philosophe paradoxal : en trébuchant sur les mots, il met à nu l’absurdité des puissants et les hypocrisies des institutions.
Le Bouif n’est pas qu’un comique de bas étage : il représente une France populaire, celle qui boit, râle, se trompe et se relève, mais qui garde toujours un œil lucide sur la comédie sociale. En lui donnant la parole, Le Canard invente une nouvelle façon de faire de la satire : non plus seulement par le trait du caricaturiste ou le pamphlet du chroniqueur, mais par le biais d’un personnage récurrent, qui deviendra bientôt familier des lecteurs. Derrière son verre, Bicard inaugure une tradition : celle du buveur comme figure politique et morale, capable de dire tout haut ce que les gens ordinaires pensent tout bas.