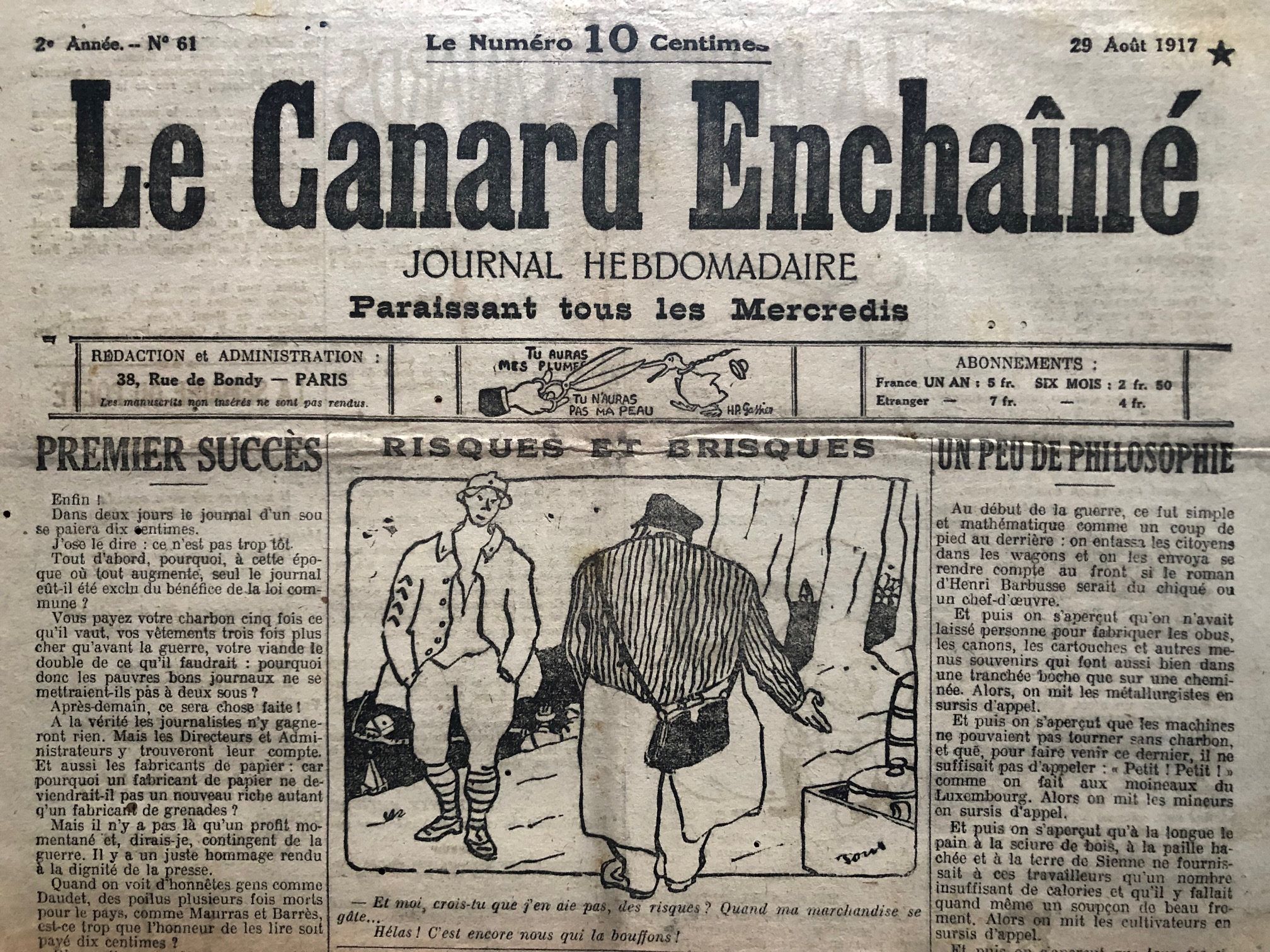N° 61 du Canard Enchaîné – 29 Août 1917
N° 61 du Canard Enchaîné – 29 Août 1917
89,00 €
En stock
Le 29 août 1917, Le Canard enchaîné hausse le ton… et son prix. Dans « Premier succès », l’augmentation du numéro à deux sous devient une victoire d’honneur, presque une conquête symbolique dans la guerre de la presse. En contrepoint, André Dahl livre sa « philosophie » des sursis d’appel, démonstration ironique où, à force de rappeler les ouvriers indispensables, on découvre que seuls les poilus restent dans les tranchées. Deux textes complémentaires : l’un affirme l’indépendance du journal, l’autre dénonce l’absurde injustice de la guerre.
Risques et brisques, par Bour.
Couac ! propose ses canards de 3 façons au choix
En stock
En une de cette édition, deux articles se répondent comme en miroir : « Premier succès », déclaration d’indépendance économique et éditoriale, et « Un peu de philosophie », satire grinçante d’André Dahl sur la mécanique absurde de la mobilisation.
« Premier succès » : l’augmentation comme victoire
Sous ce titre provocateur, Le Canard annonce qu’il passe de un à deux sous. Mais loin de s’en excuser, le journal transforme cette hausse en véritable déclaration d’honneur. Puisque tout augmente — le pain, le charbon, la viande — pourquoi la presse, « nourriture intellectuelle », resterait-elle à un prix dérisoire ? L’article renverse le sens de cette contrainte matérielle : l’augmentation n’est pas une défaite mais une conquête, une preuve de dignité professionnelle.
Derrière la boutade, une idée forte : refuser d’être ce « journal à un sou » synonyme de camelote ou de bourrage de crâne. Revendiquer un prix plus élevé, c’est revendiquer une parole libre, non inféodée aux subventions ni aux puissances de l’argent. En pleine guerre, alors que la presse est étroitement surveillée et soumise à la censure, ce geste symbolique prend valeur de manifeste.
« Un peu de philosophie » : la logique absurde des sursis
À côté de cette affirmation d’indépendance, André Dahl décortique avec ironie le mécanisme des sursis d’appel. Son raisonnement est implacable : au début de la guerre, on expédie tout le monde au front. Puis, peu à peu, l’armée se rend compte qu’il faut aussi produire : les métallurgistes sont rappelés pour les obus, les mineurs pour le charbon, les cultivateurs pour le pain, les tailleurs pour les uniformes, les maçons pour les logements. Chaque profession devient « indispensable », et obtient son sursis.
La chute est cinglante : il ne reste au front que les fantassins, les « bougres » qui, eux, ne bénéficient d’aucune échappatoire. Mais Dahl ajoute aussitôt : « Oui, mais ils s’étaient méfiés du coup : ils n’y étaient jamais venus ! » Ce trait d’esprit retourne la logique militaire contre elle-même : la guerre se réduit à une immense machine bureaucratique où l’on ne sait plus qui est mobilisé, ni pourquoi.
Deux faces d’une même médaille
Ces deux articles, lus ensemble, disent beaucoup de l’esprit du Canard en 1917. D’un côté, un journal qui revendique sa place dans le paysage médiatique, quitte à provoquer son lectorat par une hausse de prix assumée. De l’autre, une plume satirique qui rappelle que l’absurdité n’est pas seulement dans les communiqués militaires, mais dans l’organisation même de la société en guerre.
L’édition du 29 août résonne ainsi comme une double déclaration : le Canard ne sera pas un « journal à un sou » ni par son prix, ni par sa pensée. Et il continuera à pointer du doigt, avec humour et lucidité, les contradictions d’une guerre qui sacrifie toujours les mêmes.
🔎 Les sursis d’appel en 1917
Au début de la guerre, la mobilisation générale de 1914 envoie au front la quasi-totalité des hommes valides. Mais très vite, l’armée et l’État découvrent une contradiction majeure : pour soutenir l’effort de guerre, il faut aussi du charbon, du pain, des vêtements, des armes et des munitions.
C’est ainsi que furent instaurés les « sursis d’appel », dispositifs permettant de dispenser certains mobilisés de partir combattre, afin de les maintenir dans des activités jugées « indispensables à la défense nationale ». On y trouve :
-
les ouvriers de la métallurgie (usines d’armement, forges, arsenaux),
-
les mineurs de charbon,
-
les cultivateurs, indispensables à l’approvisionnement,
-
les tailleurs et cordonniers pour l’équipement des troupes,
-
les maçons et ouvriers du bâtiment pour les infrastructures militaires.
Ces sursis étaient accordés au cas par cas, souvent sur demande des entreprises ou des administrations. Ils suscitaient de vifs débats :
-
dans l’opinion, car on y voyait une injustice criante entre ceux qui risquaient leur peau au front et ceux qui restaient à l’arrière ;
-
chez les militaires, qui redoutaient un affaiblissement des effectifs ;
-
dans les usines, où les sursis devenaient parfois une monnaie d’échange avec le patronat.
En 1917, après les mutineries et les grèves contre la vie chère, le sujet est particulièrement sensible : pour beaucoup de poilus, les sursis symbolisent l’inégalité des sacrifices. Les journaux satiriques, comme Le Canard enchaîné, s’en emparent pour dénoncer la logique bureaucratique d’une guerre où l’on finit par « rappeler tout le monde, sauf ceux qui se battent vraiment ».